Etudes
Serge NEKRASSOFF, Hautes-Fagnes. Cartographie ancienne. Enseignements des cartes anciennes pour servir l’histoire du haut
plateau fagnard et retracer l’évolution de ses paysages, Waimes, Haute Ardenne, 2014, 104 p..
Outre leur aspect esthétique indéniable, les
cartes et plans sont d’un grand intérêt pour reconstituer l’histoire d’un
milieu. Par le passé, les documents cartographiques de la région fagnarde ont
été principalement consultés pour retrouver le tracé de frontières, de chemins
ou pour situer des petits monuments (bornes, croix, etc.).
Leurs enseignements dépassent pourtant largement
ces cadres. Ils livrent en effet de précieuses informations sur le couvert
végétal, l’exploitation économique, l’évolution de l’habitat, la démographie,
la toponymie, le folklore. La manière de représenter un milieu sur une carte
révèle aussi l’image que l’on a de ce milieu, l’attrait ou le rejet qu’il
inspire
La confrontation des documents cartographiques
entre eux, mais aussi avec d’autres catégories de témoignages, enrichit incontestablement
la connaissance de l’évolution des milieux fagnards depuis qu’ils sont arpentés
et exploités par l’homme.
Albert PISSART, Les « viviers » des Hautes-Fagnes. Traces spectaculaires de la dernière glaciation, Waimes, Haute Ardenne, 2014, 56 p.
Albert Pissart nous livre ici la
nouvelle synthèse de ses résultats de recherches sur le phénomène
géologique des lithalses. Visibles dans la Brackvenn, mais aussi
cachées sous la tourbe dans d’autres endroits du Haut Plateau fagnard,
les lithalses ont suscité plusieurs théories quant à leur mode de
formation à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ
13.000 ans. Leur apparence de cratère n’a cessé d’intriguer les
chercheurs depuis plusieurs décennies. Elles sont également rares sous
nos latitudes, ce qui représente un autre caractère original du milieu
des Hautes-Fagnes.
Albert Pissart, a consacré une
partie de sa carrière à déterminer leur processus de formation pour
aboutir à une théorie qui fait aujourd’hui autorité en la matière. Il
est Professeur émérite à l’Université de Liège, membre de l’Académie
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
Hans STEINRÖX, Reinartzhof und Hattlich. Zwei alte Kulturstätten im Hohen Venn, Eupen, GEV, 2013, 272 S.
Dieses Buch bietet eine umfassende
Darstellung der geschichtlichen Ereignisse rund um zwei Siedlungen im
Hohen Venn: Reinartzhof und Hattlich.
Seit die letzten Bewohner im Jahre
1971 den Reinartzhof verlassen haben, ist es dort ruhig geworden; der
Wald hat wieder vom gerodeten Land Besitz ergriffen und nur Wanderer,
Rehe und Hirsche ziehen dort ihre Bahn. Vom Reinart blieben nur ein
paar Mauerreste.
Für die Weltkriegsgeneration war
der Reinartzhof aufgrund seiner Nähe zur Grenze als Umschlagplatz für
den Kaffeeschmuggel wohlbekannt und trug auf seine Weise wirksam zum
Wiederaufbau der kriegszerstören Dörfer des Monschauer Landes bei. Den
damaligen Schmugglerkolonnen dürfte kaum bewusst gewesen sein, dass sie
sich auf ihren Wegen im Venn auf den Spuren mittelalterlicher
Pilgerscharen bewegten, die zu den Heiligtümern in Aachen und Trier
strebten.
Der Autor schildert die
Entstehungsgeschichte der Siedlung als Pilgerhospiz und erinnert an die
Menschen, die in der Abgeschiedenheit des Hohen Venns nach dem Übergang
des Hospizes zu herzoglichen Pachthöfen als Pächter - später als
selbständige Bauern - wirtschafteten und ihre Heimat hatten.
Im zweiten Teil des Buches widmet
sich der Autor der Stätte (Alt-)Hattlich und beschreibt ihre
Entwicklung von den Anfängen als Schenkung an die Prämonstratenser von
Reichenstein bis hin zur ersten Besiedlung.
Zusammenfassung aus : http://grenzecho.net/
K.D. KLAUSER, S. NEKRASSOFF, M. PAQUET et B. RAUW, 1911. Les Hautes-Fagnes en feu. Chronique de l'incendie à travers la presse régionale, Waimes, 132 p.
Au début du mois d'août 1911,
un incendie dévastateur se déclare dans les Hautes-Fagnes. A travers
les nombreux titres de la presse régionale de l'époque, les auteurs ont
retracé au jour le jour les étapes de la conflagration. Ils mettent
ainsi en lumière le combat de milliers d'hommes, belges et allemands,
civils et militaires, pour venir à bout d'un sinistre qui s'étendra sur
près de 4.000 hectares de landes et de forêts.
L'évènement est étudié sous tous ses aspects : causes,
localisations des foyers, affluence des curieux, animation autour des
établissements fagnards, relations entre les militaires belges et
allemands, incidences sur le milieu, … L'incendie de 1911 sera
également déterminant dans la création de la première association de
protection des Hautes-Fagnes.
S. Nekrassoff, Textes fagnards. Inédits - inattendus (18e-début 20e siècle), Embarcadère du Savoir - Haute Ardenne,
74 pages.
Un
des buts de ce recueil est surprendre le lecteur. Les documents
retranscrits et commentés abordent des sujets très variés, toujours
sous un jour inattendu ou méconnu : évènements et faits divers oubliés,
témoignages d'une vie quotidienne révolue aux abords du haut plateau,
hypothèses scientifiques abandonnées…
Ce sont quelques pièces bigarrées qui doivent trouver leur place dans
le tableau de l'histoire des Hautes-Fagnes. Toutes ont cependant un
point commun : elles révèlent les relations et les interactions entre
l'homme et ce milieu si particulier sous nos latitudes.
S. Nekrassoff, Michel Schmitz et la Baraque Michel. L'histoire avant la légende, 2010, 42p., illustrations.
Que
savons-nous vraiment de Michel Schmitz et de la fondation de la Baraque
Michel ? Jusqu'il y a peu, l'histoire du fondateur de la Baraque
se basait essentiellement sur des témoignages postérieurs aux faits,
parfois de plusieurs dizaines d'années. Ils étaient d'autant moins
fiables que la légende attachée au lieu a rapidement agi comme un
miroir déformant.
La
documentation rassemblée aujourd'hui n'est pas exposée à ce risque
puisque la plupart des pièces retrouvées sont antérieures à la
fondation de l'établissement, ou en sont contemporaines. Elles
apportent quelques éclaircissements, corrigent certaines
interprétations, et enfin, révèlent des éléments nouveaux.
S. Nekrassoff, Images et visages des Hautes-Fagnes. Evolution d'un paysage et de sa perception, 2007, 120 p., illustrations et photos noir et blanc.
Un autre regard sur le passé des Hautes-Fagnes.
C'est en quelques mots le résumé de cette nouvelle publication que nous
vous proposons de découvrir. Elle revisite les images du haut plateau
véhiculées depuis plus de 200 ans par les écrivains, les voyageurs, les
touristes, mais aussi les scientifiques. Elle les met ensuite en
parallèle avec des sources historiques et mesure le décalage qui existe
entre les impressions des uns et les faits transmis par les autres. Une
démarche qui révèle des écarts parfois surprenants.
Landes
inaccessibles, nature hostile, désert inculte, paysage désolé,
tourbières perfides et meurtrières. Voilà autant d’images associées au
milieu fagnard d’autrefois qui se perpétuent encore aujourd’hui.
Sont-elles fondées, ou renvoient-elles à des impressions excessives,
transmises de génération en génération ?
L’auteur
s’appuie sur de nombreux documents anciens pour mesurer l’écart qui
existe entre des images issues de sensibilités qui ont évolué au fil
des siècles et les visages du haut plateau reconstitués grâce aux
résultats des recherches scientifiques et de la critique historique.
Une démarche qui donne également l’occasion de rappeler les liens que
l’homme a entretenus avec ce milieu depuis plus d’un millénaire.
S. Nekrassoff, B. Schutz, V. Schleck, Contes, légendes et autres histoires autour des Hautes-Fagnes, nouvelle édition, 2008, 88 p., illustrations et photos noir et blanc.
Il
eut été étonnant que ce milieu si particulier ne génère pas des contes
et des légendes au sein des populations locales. La plupart des thèmes
universels y ont trouvé un cadre de choix : pactes avec le diable,
auberge rouge, feux follets, gnomes, sorciers, etc. Contrairement à
d'autres publications similaires qui mentionnent les hautes-Fagnes dans
leur titre, les récits réunis ici appartiennent exclusivement aux
villages qui entourent le haut plateau fagnard.
Le
livre recherche les origines des diverses histoires encore connues
aujourd'hui. Il tente de distinguer les récits "authentiques", racontés
lors des veillées traditionnelles, de ceux imaginés par les conteurs
régionaux (Marcelin Lagarde, Albert Bonjean, etc.).
Fagnes d'autrefois, CD-ROM, 2006, environ 300 vues commentées.
Le CD rassemble des vues de la Fagne telle qu'elle se présentait aux
yeux des premiers randonneurs, il y a un peu moins de cent ans. Le but
est de montrer l'état du paysage alors, mais aussi sa perception. La
Fagne d'aujourd'hui est pour l'ensemble de ses visiteurs un espace de
détente, de sérénité, une occasion de côtoyer la nature, et pour un
certain nombre encore, un milieu resté épargné par l'impact des
activités humaines. L'épicéa semble être là, de toute éternité ...
alors qu'il s'agit d'une culture importée il y a seulement 150 ans. Si
l'on parle aujourd'hui de l'exploitation du haut plateau, on pense
immédiatement au tourisme. Les touristes étaient bien peu nombreux au
début du 20e siècle. Ils étaient observés avec curiosité et incrédulité
par les fagnards qui habitaient les villages alentour et qui
subsistaient, en partie au moins, grâce à ce qu'ils retiraient de ce
milieu réputé ingrat.
|
|
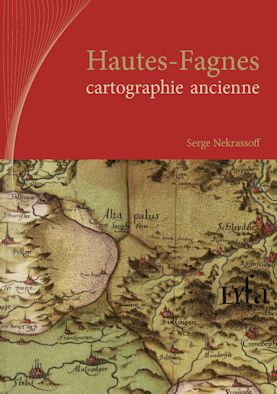
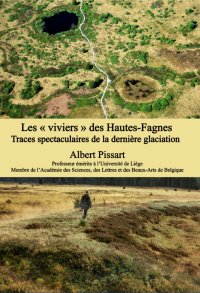
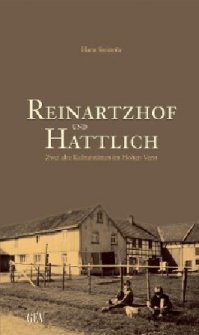
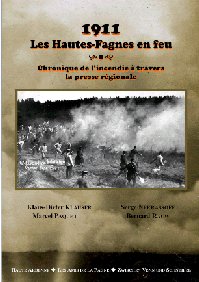


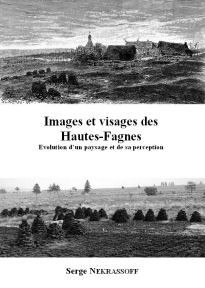
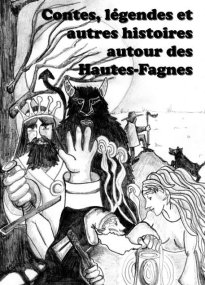
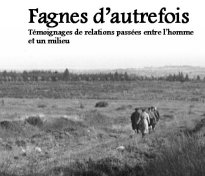
|
Les hommes et les Hautes-Fagnes, Haute Ardenne asbl,1994, 121 p.
Un
ouvrage particulièrement destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir
le passé des Hautes-Fagnes et surtout les liens que les populations
locales ont entretenu avec ce milieu depuis le haut Moyen Age : anciens
chemins, évolution de la population, exploitation des ressources
forestières, signification des noms de lieu, les peintres de la Fagne,
etc.
M.J.M. Bless et M. C. Fernandez Narvaiza, Les paysages perdus de l'Euregio Meuse-Rhin , 1996, 27 p.
C'est
à un véritable périple dans la préhistoire de la région que vous convie
cette publication. Elle décrit les différents paysages qui se sont
succédés depuis le Cambrien (il y a 500 millions d'années) jusqu'à
l'aube de notre ère, il y a 15 millions d'années. Des forêts
tropicales, des déserts, des océans ont ainsi recouvert le haut plateau
fagnard.
A. Pissart, Les "viviers" des Hautes-Fagnes, [1999], 56 p.
Les
fagnes conservent les traces d'un phénomène géologique particulier lié
à la dernière période de glaciation qui s'est achevée il y a environ
10.000 ans : les palses. Vues du ciel, elles apparaissens comme des
cratères de quelques dizaines de mètres.
S. Nekrassoff, Le Pavé de Charlemagne, une route médiévale au coeur des Hautes-Fagnes , 2002, 24 p.
Cette
route représente une véritable énigme du passé fagnard. Il s'agit d'une
véritable chaussée empiérrée suportée par une infrastructure en bois
qui lui évite de s'enfoncer dans les zones marécageuses. Un véritable
tour de force qui a du monopoliser une main d'oeuvre importante et des
moyens considérables pour sa période de construction, le haut Moyen
Age. Mais qui fut le promoteur de ce travail, et quelle fut sa
fonction. Quelques hypothèses, mais pas de certitude. |
|
|
